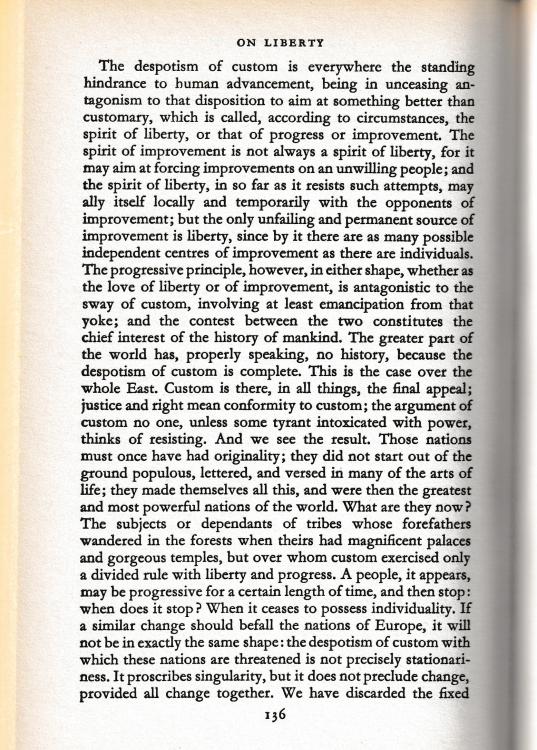-
Compteur de contenus
192 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
25
Tout ce qui a été posté par Calliclès
-

Rousseau Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes
Calliclès a répondu à un(e) sujet de coco789 dans Philosophie
Ton prof t'a donné beaucoup d'ingrédients de méthode, tu devrais y arriver. Mais il faut admettre que ce texte est particulièrement long. Dans un premier temps: "l'ataraxie des stoïciens" est quelque chose que votre prof devrait expliquer, ce n'est pas une notion connue des débutants. Les stoïciens sont une des quatre grandes écoles de pensée antiques issues de Platon (les premiers furent les cyniques, puis les épicuriens, les sceptiques et les stoïciens). Chez les stoïciens et d'autres écoles antiques, on considère qu'on peut atteindre un état mental dit "ataraxie", c'est-à-dire absence de trouble, quiétude. C'est en cela que consisterait le bonheur. Ensuite, pour le thème, c'est extrêmement simple, Rousseau l'explique dès la première ligne: la différence entre l'homme sauvage et l'homme civilisé. Pour la thèse, comme souvent dans les textes philosophiques, elle est confirmée à la fin: je te laisse la trouver. La problématique du texte, c'est tout simplement la question à laquelle répond ce texte. Si tu trouves la thèse, tu peux trouver la problématique. Pour faire court, ce texte est une apologie de ce qu'on appelle en histoire le mythe du bon sauvage. Les philosophes, comme trop souvent, on privilégié leur imagination à l'observation. Lorsque le monde moderne s'est construit par la colonisation, d'abord avec les grandes explorations maritimes du XVe et XVIe siècle (les grands voyages de Colomb, Vespuci, Magellan, Cortès, Cartier et d'autres), puis du XVIIe et XVIIIe siècle (la circum-navigation de Cook, La Pérouse, Bougainville, entre autres), les récits de cultures lointaines s'accumulent dans les bibliothèques. On parle des "sauvages" vivant dans les îles des Caraïbes ou du Pacifique. Notre sympathique Jean-Jacques Rousseau, qui aimait se faire fouetter le cul à la brosse à cheveux par une dame de Savoie entre deux confessions, imaginait que ces peuples tribaux étaient plus libres et indépendant que les civilisés. Pour son époque, c'était très moderne: il prenait à contre-pied le mépris habituel des Européens pour les civilisations qui résistent moins bien qu'eux à la variole, et qui ont le mauvais goût de ne pas avoir inventé la poudre ou l'acier pour se défendre quand les Anglais débarquent. Au lieu, comme beaucoup de ses contemporains, de dire "nous sommes supérieurs, pillons-les", Rousseau essaie d'inventer une défense des peuples colonisés, ou décimés par les virus européens. De nos jours, évidemment, on se rend compte de la naïveté de Rousseau: il parle avec de grands termes vagues et absolus de peuples qu'il n'a jamais rencontrés, dont il n'a appris ni la langue ni les coutumes, et qu'il n'a pas étudié sur le terrain. Pas de faux procès cependant: à l'époque de Rousseau, même les géologues et les naturalistes méprisaient le travail de terrain et analysaient ce qu'on leur rapportait depuis le confort de leur cabinet d'étude. Relis ce texte patiemment, savoure le style de Rousseau, considère qu'il se répète un peu et que ça devrait t'aider. Il est possible que tu n'ai pas de problème avec la philosophie, mais seulement avec le style du Français classique du XVIIIe siècle. Si tu n'y arrives pas du tout, réponds simplement à ce message, je réponds toujours dans les 24h (je suis officiellement plus efficace que le SAV de Free). -
Je fais la même chose avec mes élèves, mais je n'y passe pas le mois de septembre. Enfin bon, les collègues font ce qu'ils veulent, revenons à ton sujet: Calculer, est-ce penser? Pour que ce sujet ait du sens, il faut réfléchir à la comparaison de calcul entre un humain et un ordinateur. Si nous acceptons que calculer consiste à penser, alors les ordinateurs sont des machines pensantes. Si nous n'acceptons pas cette proposition, il faut répondre par une définition plus élargie du terme "penser", qui ne tienne pas seulement compte du calcul. Problématique: peut-on réduire la pensée au calcul? D'une part, la pensée rationnelle a besoin du calcul pour de très nombreuses raisons: qu'on mette en place un calendrier pour les récoltes dans l'antiquité, qu'on fasse de la géométrie pour les besoins de l'architecture, ou qu'on applique des modèles statistiques pour prévoir la météo. Cependant, même dans la pensée rationnelle, les mathématiques et la logique formelle, la rigueur du calcul ne sert pas à grand-chose si on n'a pas l'imagination suffisante pour anticiper certains résultats et essayer d'y tendre. D'autre part, la pensée utilise d'autres modes que le calcul seul. La pensée religieuse fonctionne sur le mode symbolique, la pensée artistique fonctionne avec des techniques qui permettent de traduire des affects dans une forme choisie (le choix des matières peut être rationnel, pour que l'oeuvre dure plus longtemps par exemple, mais pas le choix des couleurs ni des sujets choisis). Enfin, si le calcul est une forme de pensée, il faut remarquer que nous sommes généralement mauvais (les mathématiques demandent des années d'entraînement et une partie considérable de la population est tellement mauvaise qu'on peut la considérée comme des illettrés de l'algèbre), et qu'en plus de ça nous arrivons à concevoir des outils capables de calculer bien mieux que n'importe quel humain (une calculatrice pense-t-elle plus ou moins qu'un boulier? Ou qu'un ordinateur?) Si l'ordinateur spécialisé Deep Blue IV a pu battre le champion du monde d'échecs Kasparov, il faut bien admettre que Kasparov peut réfléchir à l'existence, apprendre des langues, faire de la philosophie et parler de la géopolitique, alors que Deep Blue peut seulement continuer de calculer les coups d'autres parties d'échecs. Voilà, tout ça est simplifié à l'extrême, mais je t'ai donné une problématisation et quelques pistes de réflexion, à toi de t'approprier tout ça.
-
Salut, Ce sujet est un peu difficile pour des élèves de Tle, votre prof fait une séquence sur la philosophie des sciences?
-
Q.1: Non, car de nombreux critères retenus comme essentiels sont accidentels (la langue maternelle ou certains éléments de la conscience morale). Q.2: Non, car de nombreux critères retenus comme essentiels peuvent changer au cours de la vie (exemples: le langage est essentiel mais on peut apprendre de nouvelles langues, et la conscience est essentielle mais on peut changer de point de vue moral). Q.3: Il y a des critères mixtes en jeu, et une interaction entre inné et acquis.
-
Je ne vais pas me taper un documentaire de deux heures juste pour te répondre, désolé. J'ai regardé la bande-annonce sur Youtube, ce qui ne me permet pas de répondre aux trois questions. Pour la dernière question "expliquez le titre du documentaire", ça me paraît simple: c'est un documentaire qui recueille des témoignages. Donc "ouvrir la voix" est un jeu de mot entre l'expression "ouvrir la voiE", qui signifie passer en premier, défricher le chemin, et libérer la voiX, donc libérer la parole de ces personnes. Libérer leur parole en l'exposant, justement, en leur donnant la parole pour qu'elles aient l'occasion de s'exprimer.
-

Introduction d'une dissertation philosophique
Calliclès a répondu à un(e) sujet de philosophia33500 dans Philosophie
Salut! Tu as tapé à la bonne porte. Ce sujet "A-t-on besoin de croire?" est un peu étrange pour une classe de Tle, puisque c'est une dissertation à un seul terme. Si tu es en Tle: il faut trouver le deuxième terme de la question. Ici, c'est facile: l'opposé de croire sera savoir. C'est un sujet classique sur la raison et la croyance. Je te donne quelques pistes de raisonnement: A) on ne peut pas vivre sans la moindre croyance, et nous sommes de fait obligés de croire bien des choses pour des raisons pratiques (par exemple, je prépare mes vacances de Noël, ce qui signifie que je crois très fort que Vladimir Poutine ne déclenchera pas la troisième guerre mondiale et que je serais encore en vie à Noël). Nous faisons l'hypothèse que le soleil va se lever demain, et nous faisons confiance à des gens que nous ne connaissons pas dans presque toutes nos transactions commerciales. Il semblerait que la croyance soit une nécessité pratique. B) On peut réduire le nombre de ses croyances incertaines en apprenant: c'est le rôle des connaissances. Si beaucoup de gens font l'hypothèse que le soleil va se lever demain simplement parce qu'ils en ont l'habitude, je peux étudier l'astronomie pour comprendre pourquoi le soleil va effectivement se lever demain. L'astronome ne fait pas confiance à sa croyance au lendemain, il sait que seul un événement désastreux pourrait empêcher la Terre de tourner, donc de continuer la succession des jours et des nuits. A un autre niveau épistémologique, la foi et la science peuvent proposer des réponses très différentes à une même question (d'où vient le monde? le croyant a foi en un mythe de la création, l'astrophysicien et le géologue ont des théories solidement étayées par l'analyse des roches et des météorites). Dans ce cas, le savoir rend la croyance obsolète. C) Dans nos rapports sociaux, beaucoup de croyances sont activement combattues par de nombreuses pratiques simples. Par exemple, au lieu de croire en la parole de son débiteur, un créancier peut réclamer une garantie (les banques le font sans arrêt). De cette façon, la croyance est neutralisée: le banquier n'a pas besoin de te croire sur parole lorsqu'il te prête 10 000€, il te fait signer un contrant en trois exemplaires et il te demande une garantie (par exemple: la possibilité de garder ta voiture si tu ne paies pas la dette). Qu'il te croit ou non, il est gagnant: soit tu paies ta dette avec intérêts, soit il garde ta voiture, il n'a plus besoin de croire à la parole de son débiteur. Si tu fais de la philo niveau post-bac: li faut que tu trouves une problématique sur la nécessité de croire. Tu peux faire intervenir le savoir aussi, dans une partie au moins. -
D'où sort ce texte? Pour faire court, il explique que nous comprenons le langage parce que nous connaissons les significations. Ce texte distingue les signes (la trace matérielle, comme les lettres lumineuses d'un panneau), et la signification (le fait mental que ce signe désigne un contenu, ait un sens pour un lecteur). Il en tire deux arguments qui, selon moi, ne sont pas très pertinents d'un point de vue philosophique: 1) "la communication est une apparence", la communication ne nous apprendrait rien selon l'auteur, car on ne ferait que reconnaître des significations que nous connaissions déjà dans des signes (ce raisonnement a un problème, puisqu'il faut bien qu'on nous ai appris ces significations à un moment donné, elles ne sont pas instinctives, je ne suis pas né en sachant lire)... Donc nous avons affaire à un sophisme. La communication n'est pas qu'apparence, le fait que je reconnaisse des significations dans les signes (les mots prononcés, signés ou écrits), me demande une perception et une interprétation des signes, un travail intellectuel bien préparé. Mais ce travail est récompensé par les informations portées par ces signes. Quand je lis un manuel d'instruction, ou qu'on me donne l'ordre de tirer la grand voile sur un bateau, on ne peut pas dire que "la communication ne nous apprend rien" ou qu'elle n'est qu'une "apparence", ça n'aurait aucun sens. La communication, au contraire, montre son efficacité tous les jours. Pour reprendre l'exemple de l'auteur: quand le télégramme m'annonce un désastre avec la mort de certaines personnes, je ne peux pas dire que "la communication est une apparence". Oui, pour comprendre le télégramme il faut que je sache lire, que je possède déjà l'idée de la mort, et l'idée de désastre. Mais je ne savais pas que cette personne en particulier était morte: j'ai bien appris quelque chose. D'autre part, il a bien fallu qu'on m'apprenne à lire, et qu'on m'apprenne l'idée de mort, et de personne. Ce ne sont pas des savoirs que j'ai toujours possédés, il y a eu transmission d'information, dans ma famille et à l'école, donc efficacité de la communication, pour que je sois capable de comprendre le télégramme. 2) "Mais enfin, ce n'est qu'un mirage. Si je n'étais pas là pour apercevoir une cadence et identifier des lettres en mouvement..." nous confronte à un raisonnement un peu absurde. Effectivement, le signe existe en tant qu'il est perçu (en philosophie, on appelle cette position "idéalisme" : conditionner l'existence à la perception, contrairement au "réalisme" qui va considérer que les objets et le monde existent qu'on les voit ou pas). Et s'il n'y a personne pour le lire, un journal n'est qu'une feuille de papier couverte d'encre. On peut faire le même raisonnement pour tout: si personne ne regardait la Joconde, personne ne comprendrait la beauté de son sourire... Est-ce que ça veut dire que la Joconde, ou la beauté, n'existerait pas? Dans la mesure où les signes ont été produits pour signifier quelque chose à des lecteurs, bien évidemment: ils seraient vides de sens en l'absence de lecteur, je ne vois pas où est l'information ici. A part distinguer le signifiant (le signe) du signifié (l'idée à laquelle renvoie le signe), ce texte n'est pas très utile pour comprendre la philosophie du langage, qui analyse justement le fait qu'il y a un réseau de signification et de communication grâce au langage.
-
Il faut répondre par des phrases complètes, pas juste un mot (sinon, tu ne dis rien d'intéressant). Il te faut une idée, pas un seul mot. Par exemple: doc. 1 "les gens s'entraident pour des grands travaux."
-

Comment j'ai obtenu 20/20 au Bac de Philo !
Calliclès a répondu à un(e) sujet de Kenza Ariouat dans Philosophie
Spam! -
Il suffit de lire et de ressortir l'idée principale de chaque texte. Lis chaque paragraphe et essaie de dire quelle information tu as retenue (pour le doc. 3: la domestication est un processus lent). La seule difficulté consiste dans le doc. 4, puisque ce sont des outils très différents, la réponse attendue est plus abstraite.
-

La collaboration en France durant la 2nd Guerre mondiale
Calliclès a répondu à un(e) sujet de Tatamayoux dans Histoire
La collaboration consistait à contribuer volontairement à la politique du IIIe Reich pendant l'occupation allemande. Par exemple: le Maréchal Pétain devait livrer des juifs selon des quotas définis par le Reich (comme tous les pays occupés). Pour l'année 1942, la France de Vichy devait livrer 40 000 juifs, ils en ont déporté 42 000. Du coup: Pétain -> collaboration. L'immense majorité des Français pendant la guerre n'ont ni collaboré ni résisté, ils ont juste essayé de survivre comme ils pouvaient malgré les pénuries, les restrictions et le marché noir. Après la guerre, c'est l'amnésie collective et le mythe gaulliste de "toute la France a été résistante", très éloigné de la réalité. -
Pour la consigne: Vous donnerez une estimation du nombre d'arguments présents dans le texte et justifierez votre choix en quelques mots. Vous reformulerez et présenterez les arguments selon des schémas syllogistiques en trois temps; il faudra expliciter certaines prémisses implicites et définitions dans le raisonnement. Vous joindrez une courte explication pour chaque argument. Le but est que tu découpes mentalement ce texte en étapes logiques, que tu retrouves les arguments et que tu puisses les restituer en "schémas syllogistiques". C'est une démarche analytique classique. J'imagine que votre prof vous a expliqué tous ces termes: sais-tu ce qu'est un syllogisme, une prémisse implicite ou une thèse?
-
Salut à toi, Nzoar, et bienvenue sur le sous-forum philo! Ah, John Stuart Mill, le grand philosophe de l'utilitarisme moral! Ce texte, il faut l'avouer, peut prêter à confusion pour les débutants car non seulement il est rédigé dans une langue du début du XIXe siècle, mais en plus il expose des paradoxes. Je suis allé chercher le texte original dans ma bibliothèque pour voir si la traduction était fautive, mais non: on peut se contenter du texte français. Je te donne tout de même la page fraîchement scannée (On liberty, Penguin classics, 1974, re-printed in 1985, p.136) Passons à l'analyse! 1ere phrase: Mill oppose deux concepts, le progrès et la coutume. Puis il précise que "l'esprit de progrès" est un concept portant plusieurs noms. 2e phrase: Mill analyse les différents noms de l'esprit de progrès pour tirer des distinctions, il en déduit que "progrès" et "liberté" ne sont pas identiques et peuvent même s'opposer dans certaines circonstances. Puis il place la liberté comme principe nécessaire du progrès, grâce à un autre concept central dans ce chapitre: l'individu. Le raisonnement est le suivant: si tous les individus sont libres, alors tous peuvent inventer quelque chose et faire progresser la société. 3e phrase: Il en revient à l'opposition de départ entre progrès et coutume, la tradition étant considérée comme une absence de liberté dans l'expression "empire de la Coutume". Puis il introduit un élément de philosophie de l'histoire, en considérant que la dynamique, la lutte entre coutume et progrès constitue ce qu'on appelle "histoire". 4e phrase: Il s'agit d'un simple exemple illustrant sa proposition de philosophie de l'histoire: on peut considérer qu'une partie du monde n'a "pas d'histoire", car il n'y a pas de progrès lorsque la coutume est trop puissante dans la société. Etant donné les éléments présentés plus hauts, on peut en déduire que Mill parle de société sans individualisme, dans lesquelles les individus sont écrasés par le poids des traditions. Effectivement, dans un pays où rien ne bouge et les innovations sont combattues par la tradition, on peut imaginer qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, pas de changement social majeur à répertorier. Il s'agit d'un exemple très hypothétique, puisque les sociétés ne vivent pas isolées, une nation figée par la tradition finirait par rencontrer l'histoire à cause d'une guerre, en se faisant envahir par une nation qui aurait investi son innovation technique dans l'armement. Puisque je suis allé cherché le bouquin, je sais que ce dernier exemple parle de "tout l'Est", mais difficile de savoir si Mill parle du Moyen-Orient, de l'Inde ou de la Chine, ou des trois en même temps. Puisqu'il était Britannique au XIXe siècle, je mets une pièce sur l'Inde et sa société de caste. Ceci étant dit, passons à la formulation! Tu connais la technique? En philosophie, pour parler d'un texte, on se pose 4 questions: Quel est le thème? Autrement dit: de quoi ça parle? Et bien, de l'opposition entre progrès et tradition, ce que Mill appelle "empire de la Coutume" et "esprit de progrès". Quelle est la thèse du texte? La lutte entre progrès et tradition repose sur la liberté individuelle, et est constitutive de l'histoire (il y a donc deux éléments: une thèse et sa corollaire). Quelle est la problématique? Cela pourrait être "qu'est-ce que le progrès?", mais la question est un peu vaste. C'est plutôt "quel est l'élément moteur du progrès?" Quel est le plan? Je te laisse décider. Je t'ai donné beaucoup d'indices, beaucoup de réponses directes, là je vais te laisser bosser. A toi de voir comment tu veux découper ce texte, comprends-tu où sont les articulations logiques de l'argumentation?
-
En tant qu'helleniste amateur, ça me fait très plaisir de voir un passionné de langues anciennes sur le forum. Bienvenue parmi nous!
-
Je te réponds 4 ans plus tard: salut! Je n'avais pas spécialement cherché la salle des profs sur ce forum, merci de l'accueil!
-
Si vous débarquez sur le site et que vous passez de la première à la terminale: bienvenue à tous! C'est à vous que je m'adresse. Déjà, le programme de philosophie n'est pas un mystère, c'est un document public que vous pouvez consulter ici: https://eduscol.education.fr/document/24043/download Comme mentionné dans ce programme, votre prof de philo peut choisir des auteurs librement pour illustrer ses cours. Il ou elle peut se cantonner aux classiques, ou aller chercher des auteurs moins connus et plus contemporains. Qui sont les classiques absolus de la philosophie? Je vais être synthétique, on peut en retenir douze pour cheminer de l'antiquité à la modernité : Platon, Aristote, Augustin d'Hippone, Thomas d'Aquin, René Descartes, Thomas Hobbes, G.W. Leibniz, Baruch Spinoza, Emmanuel Kant, G.W.F. Hegel, Edmond Husserl. Voilà une liste très raccourcie, amputée de beaucoup d'auteurs majeurs et fondateurs, mais permet d'avoir une introduction rapide. Cependant, si votre prof de philo a une totale liberté de choix pour les auteurs de textes à analyser en classe, il a tout de même une contrainte. L'oeuvre qu'il vous proposera en lecture suivie viendra forcément d'un de ces auteurs: Les présocratiques ; Platon ; Aristote ; Zhuangzi ; Épicure ; Cicéron ; Lucrèce ; Sénèque ; Épictète ; Marc Aurèle ; Nāgārjuna ; Sextus Empiricus ; Plotin ; Augustin ; Avicenne ; Anselme ; Averroès ; Maïmonide ; Thomas d’Aquin ; Guillaume d’Occam. N. Machiavel ; M. Montaigne (de) ; F. Bacon ; T. Hobbes ; R. Descartes ; B. Pascal ; J. Locke ; B. Spinoza ; N. Malebranche ; G. W. Leibniz ; G. Vico ; G. Berkeley ; Montesquieu ; D. Hume ; J.-J. Rousseau ; D. Diderot ; E. Condillac (de) ; A. Smith ; E. Kant ; J. Bentham. G.W.H. Hegel ; A. Schopenhauer ; A. Comte ; A.- A. Cournot ; L. Feuerbach ; A. Tocqueville (de) ; J.-S. Mill ; S. Kierkegaard ; K. Marx ; F. Engels ; W. James ; F. Nietzsche ; S. Freud ; E. Durkheim ; H. Bergson ; E. Husserl ; M. Weber ; Alain ; M. Mauss ; B. Russell ; K. Jaspers ; G. Bachelard ; M. Heidegger ; L. Wittgenstein ; W. Benjamin ; K. Popper ; V. Jankélévitch ; H. Jonas ; R. Aron ; J.-P. Sartre ; H. Arendt ; E. Levinas ; S. de Beauvoir ; C. Lévi-Strauss ; M. Merleau-Ponty ; S. Weil ; J. Hersch ; P. Ricœur ; E. Anscombe ; I. Murdoch ; J. Rawls ; G. Simondon ; M. Foucault ; H. Putnam Ce qui nous fait beaucoup, beaucoup de possibilités... Alors évidemment, aucun prof de philo sain d'esprit ne vous demandera de lire Le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhaueur en Terminale... Peut-être parce que c'est déprimant, ou parce que mon édition de poche, publiée au PUF en 2008, fait 1435 pages et 930 grammes (paye ta poche!) Si un prof de philo veut absolument vous introduire aux délices de la philosophie allemande pour dépressifs chroniques, il choisira plutôt De la quadruple racine du principe de raison suffisante, qui est tout même massif, mais plus abordable. Alors, quoi lire? Ce site donne une liste avec laquelle je suis profondément d'accord: https://liep.fr/lectures-philosophiques-pour-tous-les-futurs-eleves-de-terminale-2020-2021/ C'est une liste élaborée pour l'année 2020-2021, mais elle réunit tous les auteurs classiques et les bouquins les plus souvent recommandés par les collègues. Vous pouvez presque y choisir une oeuvre au hasard. Et où on peut lire ça? Il faut les commander chez un libraire? Pas forcément. Si la lecture en ligne ne vous gêne pas, tous ces auteurs morts sans ayant-droit vivant sont consultables gratuitement et légalement. L'Académie d'Amiens a fait une excellente liste de liens pour trouver les textes de philo dont vous aurez besoin en terminale: http://philosophie.ac-amiens.fr/spip.php?article200 Mais vous pouvez aussi chercher ces textes sur wikisource, qui n'a pas toujours les meilleures traductions, puisqu'elle se cantonne aux vieilles traductions libres de droit: https://fr.wikisource.org/wiki/Portail:Philosophie Je veux m'en tenir aux Anciens, la philosophie grecque des origines. Dans ce cas, je vous conseille une excellente introduction à l'oeuvre de Platon: l'Apologie de Socrate. C'est le procès de Socrate, le maître de Platon, et écrit sous forme de dialogue. Socrate est accusé de corrompre la jeunesse avec une philosophie qui détournerait les jeunes de la religion, mais il va répondre à ses accusateurs avec beaucoup d'humour, d'esprit, et leur présenter de nombreuses remises en question. A lire ici dans une traduction libre de droit: https://fr.wikisource.org/wiki/Apologie_de_Socrate_(trad._Croiset) Ou à commander chez votre libraire dans une édition récente, je propose Apologie de Socrate (suivie du Criton) chez Garnier-Flammarion, 5€. Il existe des éditions moins chères, mais GF fait un très bon travail d'introduction et vous aurez une traduction récente particulièrement attentive aux notes de civilisation. Je préfère un auteur français à lire dans le texte, pour ne pas m'encombrer avec ces histoires de traduction. Aucun problème, la philosophie française s'est illustrée à différentes périodes de l'histoire et compte de nombreux auteurs fondateurs. Deux choix: Le Discours de la méthode de René Descartes, pour vous initier au rationalisme humaniste de la période classique, avec des questionnements sur la nature de la raison et nos différences d'avec les animaux. Là encore, préférez les éditions GF, ou allez le lire ici: https://fr.wikisource.org/wiki/Discours_de_la_méthode_(éd._Cousin) Sinon, pour vous initiez au questionnement des civilisations et de l'histoire, qui abordent des questions politiques et les futures sciences humaines, je suggère le Second discours de J.-J. Rousseau (titre intégral: Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes). https://fr.wikisource.org/wiki/Discours_sur_l’origine_et_les_fondements_de_l’inégalité_parmi_les_hommes Pour une réflexion plus moderne permettant de comprendre la philosophie française au XXe siècle, on peut lire L'existentialisme est un humanisme, une petite conférence très synthétique de Jean-Paul Sartre (peu importe l'édition). Je m'intéresse à la philosophie politique: le concept d'Etat, l'autorité, les lois et l'histoire. Dans ce cas, partons sur un classique absolu dont vous ne prendre que quelques chapitres: Le citoyen de Thomas Hobbes. Comment les hommes sortent de l'état de nature, renoncent à leur droit naturel à la violence, pour se protéger en légitimant la violence d'un monstre qui rassemble le droit à la violence de tout le monde: l'Etat! Lisez la section 1 de ce livre ici: https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Citoyen Sinon, bien sûr, vous pouvez apprendre la philosophie du mal avec Nicolas Machiavel, qui explique pourquoi les politiques doivent mentir et comment gagner des guerres dans son manuel politique célèbre, Le Prince : https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Prince Je suis dans un parcours scientifique, est-ce qu'il y a des philosophes qui parlent de science et qu'on peut essayer de lire en terminale? Quelque chose qui va me servir, si je veux devenir ingénieur ou physicien? Oui, bien sûr! La philosophie des sciences, ou épistémologie, est une discipline abordable. On pourrait lire La formation de l'esprit scientifique de Gaston Bachelard (je recommande les éditions Vrin pour cet ouvrage, mais je ne mets pas de lien pour le lire gratuitement, car Bachelard n'est pas encore dans le domaine public en Europe apparemment). C'est un catalogue des erreurs de scientifiques: comment on peut se tromper dans sa théorie, pourquoi, quelles sont les tendances idéologiques et pseudo-scientifiques à contourner? C'est ce que Bachelard appelle des obstacles épistémologiques. Si vous souhaitez lire quelque chose vous donnant une théorie philosophique de la démarche scientifique elle-même, mais de façon abordable, je vous conseille Sauver les apparences de Pierre Duhem, à acheter aux éditions Vrin ou à lire en ligne ici (ne vous laissez pas effrayer par le titre en grec, le texte est en français): https://fr.wikisource.org/wiki/ΣΩΖΕΙΝ_ΤΑ_ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Je m'intéresse au rapport entre la philosophie et la religion, à la foi. Cap vers la philosophie médiévale, ou celle de l'Antiquité tardive, pour découvrir la métaphysique religieuse: la théologie. Voici le récit le plus touchant de théologie qu'on puisse trouver, par un philosophe tellement influent qu'il est considéré comme un saint par les chrétiens: Les confessions d'Augustin d'Hippone. S'y trouve le récit de sa conversion au christianisme (puisqu'auparavant il était manichéen, une religion antique aujourd'hui disparue), ainsi que de nombreuses réflexions sur la nature de dieu, de l'esprit et du temps. Je conseille la lecture du livre XI pour commencer. A lire chez GF ou ici: https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Confessions_(Augustin)/Livre_onzième Et la philosophie arabe? Si la civilisation arabo-musulmane vous intéresse et que vous souhaitez découvrir sa philosophie médiévale originale, je vous conseille très vivement le magnifique Al-Hasif, ou Discours décisif, d'Averroès. Ce texte présente les différentes catégories de raisonnement possibles et le niveau de certitude qu'ils permettent d'atteindre, pour en déduire une division de la population en différentes catégories plus ou moins capables de raisonner (et vous verrez, Averroès n'est pas tendre avec les juges coraniques, qui devraient laisser les philosophes en paix, ou encore avec les non-philosophes qui sont comparés à des animaux... oui, ce n'est pas un texte très rassembleur, mais la philosophie médiévale n'est pas la plus égalitaire, et Averroès signe un plaidoyer pour la liberté de pensée des érudits). GF a là encore proposé une excellente édition bilingue, avec le texte en Français et en Arabe littéraire, dans une traduction de Marc Geoffroy accompagnée de notes de civilisation. Moi, je n'ai aucune idée de ce que je veux lire! Je ne sais même pas ce que c'est, la philosophie, comment je peux apprendre en quoi ça consiste avant de lire les auteurs classiques? Dans ce cas, une excellente explication de la démarche philosophique se trouve dans le petit texte de Kant: Qu'est-ce que les Lumières? Il y a une très bonne édition scolaire chez GF pour 4€, sinon on peut la lire ici: https://fr.wikisource.org/wiki/Métaphysique_des_mœurs_(trad._Barni)/Tome_I/PERAD/Réponse Moi, je pense que la philo, c'est nul! Et bien tu n'es pas le seul. Bertrand Russel, un philosophe analytique, commençait une conférence par "Depuis les temps les plus reculés, plus que toute autre branche du savoir, la philosophie a eu le plus d'ambition et atteint le moins de résultats." Effectivement, la philosophie prétend nous apprendre plein de trucs, mais on ne voit pas beaucoup de philosophes en-dehors de plateaux télé où ils racontent des conneries, et des lycées où ils enseignent... la philosophie. Peut-être parce que la philosophie ancienne est dépassée, qu'elle devrait intégrer des méthodes plus scientifiques, ou peut-être parce qu'une philosophie qui réussit à apporter des résultats concrets devient autre chose et qu'on ne l'appelle plus philosophie. La philosophie, une machine à donner naissance à de nouvelles sciences? Je recommande La méthode scientifique en philosophie, de Bertrand Russel, à lire chez Payot.
-
Je trouve ce texte absolument magnifique, c'est la profession de foi du philosophe qui croit au pouvoir de la raison, Socrate libérant les gens de l'ombre par la connaissance de soi, bref: tout un mysticisme que le christianisme essaie de singer sans y parvenir et sans proposer de profondeur intellectuelle. Comme disait Nietzsche: le christianisme, c'est du Platon mal expliqué au peuple. Bref, laissons de côté mon avis personnel et reprenons nos quatre éléments de l'intro du commentaire de texte: Thème: Les vertus de la philosophie chez Platon. Thèse: La philosophie socratique consiste à combattre l'ignorance, qui génère tous les problèmes qu'on peut rencontrer ensuite dans la société ou en soi. Problème: Qu'est-ce que le socratisme, ou la pensée de Socrate? Enjeu: Un pan entier du rationalisme est empreint de la philosophie socratisme: libérer par le savoir. Que ce soit la gnostique antique ou médiévale, qui s'étale de Pythagore à Plotin, ou la résurgence d'une libération des peuples (et pas seulement des âmes) grâce au savoir avec les Encyclopédistes des Lumières, ou encore une partie de la pédagogie qui prend la maïeutique socratique comme point de référence (sinon comme date de naissance), ce texte résume l'importance de la figure socratique pour les philosophes.
-

Correction dissertation: L'Etat et la justice
Calliclès a répondu à un(e) sujet de DJhuff dans Philosophie
Alors DJhuff? Cette épreuve de philo? Quel sujet as-tu pris? -
Voici ce qui est tombé aujourd'hui pour les bacheliers 2022 du bac général: Sujet 1 : Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Sujet 2 : Revient-il à l’Etat de décider de ce qui est juste ? Sujet 1: Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? La notion d'art a été remplacée par "pratiques artistiques" pour plus d'ouverture, peut-être. Rappelons que beaucoup de civilisations n'ont pas de mot pour "art". C'est une question qui ressemble énormément aux sujets bidons de français qu'on connait bien: "l'artiste peut-il changer la société?" et autres conneries. Mais puisqu'on est en philo, cette fois-ci on va pouvoir réfléchir et donner une réponse sensée au lieu de citer Zola et Victor Hugo. Sous des dehors modernes, c'est la question bien classique de l'utilité de l'art qui vous est posée. Le problème: l'art parle de la société, le commente et transmet une image durable de cette vision sociale de l'artiste, et pourtant ce n'est absolument pas son rôle de changer la société. Bref, les pratiques artistiques ne sont pas de la politique, donc l'art serait un éternel commentateur inutile... et pourtant, la politique utilise l'art, sa puissance évocatrice, et peut même censurer des pratiques artistiques en fonction des tendances. Si votre problématique s'articule autour d'art et politique: c'est gagné. Si vous posez plus largement la question de l'utilité de l'art, avec au moins une partie de la dissertation consacrée à l'impact politique de l'art, c'est gagné. Les exemples: Si vous avez parlé de propagande, d'art fasciste, ou encore de critique politique par l'art, vous avez probablement gagné des points. On peut citer l'affiche rouge pendant la seconde guerre mondiale, la censure de l'art expressionniste par les nazis, on peut éventuellement parler de la critique de l'art par Platon (pas forcément pertinent, à utiliser à vos risques et périls). Et puisqu'on parle du "monde", qui n'est pas la notion la plus réduite en philosophie, il est possible de parler d'autres choses. Remplacer le mot "art" par "pratiques artistiques" permet de parler de la pub, de la propagande bien sûr, mais aussi, pourquoi pas: de l'art-thérapie. Ces exemples n'étaient pas hors-sujet, si vous les avez connecté à votre problématique. Une éventuelle sous-partie sur la gratuité de l'art, et sa nécessité d'être décorrélé du monde pour durer en tant qu'oeuvre, aurait sa place dans l'antithèse, si vous êtes chauds pour citer les dadaïstes et autres surréalistes. Les hors-sujets: Si vous avez commencé à dérouler de longs arguments pas toujours clairs sur l'état du monde, la guerre et le réchauffement climatique, en oubliant les pratiques artistiques, c'est perdu. Même chose si vous avez centré votre dissertation sur l'art pur sans jamais parler de politique ou d'applications pratiques de l'art, vous êtes en hors-piste sans combinaison. Sujet 2: Revient-il à l’Etat de décider de ce qui est juste ? Inévitable sujet politique pour une année électorale! L'Etat, vous vous souvenez de vos cours? Machiavel, Hobbes, Arendt, emballez, c'est pesé: il va falloir définir l'Etat. Puisque ce sujet parle d'Etat et de justice, vous devez définir les termes. Il est possible d'utiliser des notions connexes, comme la morale, à condition de ne pas centrer sa dissertation dessus et de les utiliser dans des parties ou sous-parties spécifiquement consacrée à l'exploration de ce rapport. Le problème: N'oubliez pas que vous devez surtout trancher la question suivante: qui décide de ce qui est juste? Si l'Etat décide, un chef d'Etat, ou ancien chef d'Etat ne peut jamais être jugé et il n'y a pas de justice (pas vrai, M. Sarkozy?) Si ce n'est pas l'Etat, on peut se demander qui? Les entreprises? La société civile? Les magistrats, bien sûr, c'est leur boulot. Parlez de la séparation des pouvoirs, mais aussi du rôle des institutions judiciaires. C'est une dissertation parfaite pour ceux qui s'intéressent au droit et à la politique. Il y a un paradoxe car la justice doit pouvoir juger des personnes d'Etat pour lutter contre la corruption, et l'Etat doit garantir la justice: pas simple! Si vous avez compris ce problème et que votre problématique connecte bien Etat et justice, sans abandonner un des termes, vous gagnez des points. Les exemples: la corruption, les conflits d'intérêt, le rôle de l'Etat comme garant des institutions, la séparation des pouvoirs (oui, on peut citer Montesquieu et l'Esprit des lois, on DOIT citer Montesquieu), mais également les intuitions morales qui précèdent la justice, donc les théories morales que vous maîtrisez suffisamment pour les citer. Mais encore: une sous-partie questionnant le rôle de l'Etat, donc un petit rappel du contrat social (Hobbes ou Rousseau, au choix) peuvent être utiles. Si vous avez le bon goût de citer un théoricien de la justice, comme Rawls ou Beccaria, bravo, mais c'est délicat: attention à bien rester dans votre problématique. Les hors-sujets: Si vous êtes parti en roue libre sur une loooooooongue définition de l'Etat, en oubliant le rapport à la justice pendant une partie entière, j'ai de mauvaises nouvelles... L'inverse n'est pas tout à fait vrai: si vous parlez de justice seule pendant une partie entière, mais en gardant en tête le "qui décide?", vous êtes dans les clous. Par contre, si vous êtes partis sur des propos de comptoir, du genre: "de toute façon, les politiques ne vont jamais en prison, alors c'est pas juste et c'est comme ça", sans poser de question, alors vous n'avez pas écrit de propos philosophiques, vous avez juste confondu l'épreuve du bac avec une discussion de vieux alcoolisés dans un bar PMU. Sujet 3: Extrait d'un texte de Cournot. C'est un très beau texte d'épistémologie, donc de philosophie de la connaissance. Si vous avez casé le mot "épistémologie" dès l'intro, vous commencez à gagner des points. Le thème: Ce texte parle de la définition d'une expérience scientifique, et en quoi elle diffère d'une observation strictement intérieure, sur les états mentaux. La thèse: C'est la première phrase, précisant qu'une observation est scientifique si l'on défini précisément les conditions auxquelles on peut la reproduire. Le problème: Qu'est-ce qu'une observation scientifique? Le problème plus vaste est la légitimité de la science, sa spécificité par rapport à d'autres observations. L'enjeu: C'est la définition de la science elle-même qui se joue dans ce texte. En donnant un critère de scientificité aussi précis, Cournot nous renseigne sur un aspect fondamental de l'expérience scientifique: son indépendance de l'observateur, et nous met en garde contre des expériences que personne ne pourrait reproduire.
-

Correction dissertation: L'Etat et la justice
Calliclès a répondu à un(e) sujet de DJhuff dans Philosophie
Pour ce nouveau sujet "Discuter, est-ce renoncer à la violence?", tu peux entièrement associer "langage" et "discussion" car le sujet le formule ainsi. En choisissant le mot "discuter", le sujet écarte un certain nombre de débats sur le langage (le rapport du mot à l'idée par exemple) pour se concentrer sur le dialogue. Donc tu ne serais pas hors-sujet du tout, mais bien dans les clous. Ta problématique est excellente, tu as bien cerné le sujet. Attention, ceci est une anecdote impromptue: Le sujet du renoncement à la violence par le langage est le premier sujet que j'ai eu à traiter lorsque j'étais élève en Terminale L. Nostalgie! Je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai répondu, mais ma première note était 12 ou 13 environ: c'était pas génial. -

Correction dissertation: L'Etat et la justice
Calliclès a répondu à un(e) sujet de DJhuff dans Philosophie
Bonjour, j'ai réalisé un plan de dissertation à partir du sujet suivant: Peut-on dire qu'il n'y a pas de justice, mais seulement des lois ? C'est un sujet des plus classiques, un excellent choix pour de l'entraînement. On peut citer: La loi est-elle une garantie contre l'injustice ? (sujet de remplacement pour série Technique Sportifs de haut niveaux en 1997, code épreuve: 97PHTEHN3) La justice peut-elle se passer de la loi ? (sujet pour série Technique de la musique et de la danse, 2005, code épreuve: 05PHMIME1) Est-ce la loi qui définit ce qui est juste ? (sujet pour séries Technologiques en 2011, code épreuve: 11PHTEME1) Et une dizaine d'autres sujets très similaires, il ne m'a pas fallu longtemps pour constater la popularité de ce sujet dans la base de données BDBac, codée par les collègues de l'université d'Aix-Marseille en 2015 (merci à eux, ils sont géniaux) Puisque nous sommes dans une année d'élection, je te suggère de ne pas faire l'impasse sur la philosophie politique et la notion d'Etat. Je ne suis pas Madame Soleil, mais pendant les années électorales il y a souvent un sujet de ce genre qui traîne. Je vous prie d'y apporter une correction avant le 15 Juin, date de l'épreuve. Mais bien évidemment! " Peut-on dire qu'il n'y a pas de justice, mais seulement des lois ? Amorce: Le IIIème Reich a édicté des lois qui obligeaient les juifs à porter un signe distinctif tu peux dire simplement "les lois de Nuremberg de 1935", tout le monde connait, à vivre dans des quartiers précis, à les empêcher de se marier avec des Allemands non juifs. Il autorisait la déportation des populations juives, leur esclavage en pratique oui, puisque les camps de concentration sont des camps de travail forcé, mais le terme n'est pas utilisé par les historiens pour décrire la situation des prisonniers car l'esclavage est d'abord une pratique économique, ce qui n'était pas le cas, je te conseille de l'enlever par soucis de clarté et leur extermination là par contre, c'est le bon terme, la population était forcée d'obéir à des lois. Bien que la justice soit une notion sujette à controverse, car elle peut être définit comme un ensemble de valeurs qui diffère d'un individu à l'autre, toute personne s'accorde à dire que le IIIème Reich était fondamentalement injuste ça va être difficile de trouver un contradicteur, à moins d'aller chercher des vieux c... Monsieur Zemmour? Qu'est-ce que vous foutez là? Problématique: L'Etat garantit-il des lois compatibles à avec la notion de justice ? Mouais, c'est pas une dissertation sur l'Etat, donc attention. Je sens venir le hors-sujet dans 3... 2... 1... -La justice serait-elle contraire à l'Etat ? Boum! Hors-sujet! Les lois et l'Etat ne sont pas équivalents. +L'Etat institue des lois qui favorisent bien souvent ceux qui les édictent. Il est alors source d'inégalités. Ce sont ces inégalités mêmes qui peuvent être à la base du sentiment d'injustice touchant les personnes qui ne profitent pas des effets de ces lois. En ce sens, la notion de justice serait purement subjective, il dépendrait à chacun de juger de la compatibilité ou non entre justice et Etat. Par exemple, les Etats des sociétés développées de notre époque ont de multiples similitudes car ils accordent une grande importance à l'économie. Les moyens de production et les richesses sont détenus par une minorité, fait favorisé par le cadre juridique de nos sociétés, lors que la majorité ne profite pas du fruit de son labeur. En ce sens, l'Etat est source d'injustice pour une grande partie de la population. Un exemple précis serait la bienvenue. +Les Etats peuvent être une forme d'oppression sur leurs populations. Au fur et à mesure que les Etats se sont agrandis - passant de la cité grecque, par exemple, de César ou de Napoléon - ils sont devenus plus autoritaires, écrasants par rapport aux populations. La où l'Etat n'est pas un empire, il cherche à le devenir (comme dans l'Allemagne nazie ou en Russie soviétique) et ses chefs deviennent des dictateurs. C'est ce qu'illustre Friedrich Nietzsche en disant: "L'Etat est le plus froid des monstres froids". Contre-sens: notre sympathique Friedrich n'avait rien à dire sur les totalitarismes, puisqu'il est mort de la syphilis en 1900 après dix ans de silence. Donc nous sommes certains qu'il ne parlait pas d'Hitler ou de Staline, et en plus sa philosophie politique est pratiquement inexistante! Très mauvais auteur pour cet exemple, c'est une pure citation de complaisance sortie de nulle part et collée ici pour faire beau. Par exemple, dans la tragédie antique d'Antigone de Sophocle, Antigone est une jeune fille révoltée contre la loi de la cité (c'est-à-dire de l'Etat) représentée par son oncle Créon: ses deux frères s'étant entretués au cours d'une bataille pour le pouvoir, l'un d'eux a été privé de sépulture par Créon. Antigone veut l'enterrer religieusement. Dans cet exemple, Hegel voit le conflit du droit familial, représenté par Antigone, et du droit de l'Etat, représenté par Créon. Antigone invoque des valeurs considérées comme justes mais que Créon (autrement dit l'Etat) rejette. Excellent exemple: c'est bien le sens du dilemme entre Créon et Antigone, l'opposition de la morale et de la loi, c'est bien interprété et pertinent! +L'oppression de l'Etat sur la société peut se transformer en véritable totalitarisme. L'Etat est alors contre la société humaine qu'il contrôle voire détruit. Hannah Arendt, qui a étudié les régimes totalitaires, considère le totalitarisme comme un phénomène de "masses". Pour elle, ces "masses" sont perdues, elles ont besoin d'un modèle fort et acceptent facilement les idéologies totalitaires. Le totalitarisme se caractérise par un Etat maximal qui concentre toute l'autorité entre les mains d'une seule personne au point de réglementer elle-même la société, l'économie et les libertés publiques. Ces dernières tendent à disparaître du fait du poids de la censure et de la police. Par exemple, le dictateur de la Russie soviétique, Staline, a sacrifié une partie importante de la population de son pays pour la croissance de son économie et l'affirmation de son contrôle total sur la population. Au total, les experts estiment que plus de 50 millions de soviétiques ont été victimes du régime politique de Staline de 1930 à 1950. La justice, bien que son acception en tant que système de valeurs diverge d'un individu à l'autre, est alors en totale contradiction avec l'Etat et les lois qu'il édicte. Attention tout de même, Arendt décrit le totalitarisme comme un système de surveillance de chacun par tous, pas seulement une concentration de pouvoirs entre les mains d'un seul [censure]: si c'était le cas, pas besoin de parler de totalitarisme, le mot "dictature" suffirait. Transition: La justice en tant qu'ensemble de valeurs semble donc contraire à l'Etat, car celui-ci est toujours source d'injustices et d'inégalités pour une partie de la population. Souvent, il oppresse même les populations qu'il contrôle. Oui, et c'est parce que cette partie est hors-sujet. L'Etat n'étant pas la loi, on peut dire qu'il oppresse et dérive en manipulant les lois, sans rien dire d'intéressant sur la notion de loi elle-même. C'est ta troisième sous-partie, autrement bien écrite, qui tombe complètement dans le hors-sujet à cause de la confusion de départ. Cette partie est relevée par ton superbe exemple tiré de Sophocle, mais tu as gâché la sous-partie sur Arendt. Cette oppression peut aller jusqu'à la destruction de la population. Définir la justice autrement que comme ensemble de valeurs pourrait apporter une solution. -La justice et l'Etat peuvent-ils coexister ? Toujours hors-sujet, quand va-t-on parler de la loi? +La justice n'a pas de définition universellement approuvée. Certains s'entendent pour la décrire en tant que système de valeurs ce serait plutôt la morale, ça, d'autres en tant que formes ...de triangle, de carré? En formes de quoi?. Si l'on considère la justice comme un ensemble de valeurs, la liberté et l'égalité en sont les principes majoritairement approuvés. L'Etat est le cadre juridique régi par une constitution. D'après de nombreux philosophes, tels que Hobbes ou Rousseau, l'être humain vivait à l'état de nature en société. Cet état de nature a entraîné une insécurité, qu'illustre Hobbes avec sa fameuse citation: "Et comme il est vrai, et qu'un homme est un dieu à un autre homme, et qu'un homme est un loup à un autre homme". Hobbes sous-entend par là que tout homme, étant libre de faire ce qu'il veut dans l'état de nature, peut donc librement priver d'autrui sa liberté. L'état de nature est alors source d'injustices pas encore: puisqu'il n'y a ni lois ni justice dans l'état de nature, il n'y a pas non plus d'injustice, juste de la force et des opportunités. La solution a été donné par l'instauration de l'Etat, qui permet d'assurer à chacun la sécurité contre la suppression d'une partie de leur liberté. L'Etat est alors synonyme de justice pas encore, il est synonyme de renoncement par chacun à son droit à la violence. Par exemple, Athènes est la première cité à réaliser effectivement la démocratie. La démocratie est un régime politique dans lequel le peuple élit ses dirigeants. Ainsi, l'Etat est ici juste dans le sens qu'il assure l'égalité et la liberté des citoyens Athéniens. +Pour le philosophe Hobbes, la justice n'existe pas à l'état de nature. Ah, on abandonne l'exemple d'Athènes, on repart sur Hobbes? Du coup, je ne vois pas l'intérêt d'avoir introduit Athènes à la phrase précédente. L'ordre de justice se met en place à partir du moment où l'être humain vit en société. Pour assurer la sécurité de cette société humaine, il est nécessaire que chacun obéisse aux lois de son pays, que chacun les respecte. Dans cette perspective, la justice ne correspond pas à l'institution de telle ou telle règle particulière: elle relève de la nécessité de l'institution d'une règle mais ne dépend pas du contenu de cette règle. Ah, un argument intéressant! J'en veux plus, développe. Par exemple, dans cette approche, cela signifie qu'obéir à des lois comme celles de l'Etat de Corée du Nord qui obligent chaque citoyen à la formation militaire et au culte quotidien de Kim Jong-Un est la définition même de la justice. Ici, justice et Etat sont donc strictement identiques. Merde, on t'a perdu, DJhuff, tu tenais une distinction conceptuelle intéressante avec la phrase d'avant et là tu pars dans un exemple en mousse qui n'a rien à voir avec le raisonnement défendu, quel dommage! On est passé à un cheveux d'avoir une excellente sous-partie! +Le libéralisme est une idéologie qui semble combiner justice et Etat WTF???. Dans le concept de libéralisme, défendu par Adam Smith et John Locke notamment, l'Etat n'occupe qu'une fonction sécuritaire, la justice se fait d'elle-même. L'Etat "libéral" est un Etat minimal qui assure la sécurité sans gêner le libre-échange qu'il favorise le plus possible. Par exemple, le régime politique français actuel peut être considéré comme libéral. L'Etat laisse de nombreuses libertés, telles que celles de se déplacer, de s'exprimer, de penser, et favorise effectivement le commerce. Il n'y a ainsi aucune restriction douanière des échanges entre les différents pays de l'Union Européenne ce qui relève d'une politique fédéraliste et inter-étatique qui n'a plus rien à voir avec ton argument sur l'Etat, tu changes de sujet trop facilement. Justice et Etat semble alors coexister effectivement. Transition: L'Etat fût institué car l'état de nature était injuste pas injuste, puisqu'il n'y avait pas de justice, dis plutôt que l'état de nature est insupportablement violent. Il a permis l'émergence de la justice ou de l'Etat, mais tu sembles confondre les deux depuis le début, donc au moins tu es cohérent dans ton hors-sujet. De plus, considérer la justice en tant que forme de quoi? "la justice en tant que forme" ne veut pas dire grand-chose, tu veux dire en tant que structure, institution? et non en tant qu'ensemble de valeurs revient à la considérer comme l'expression de l'Etat, quel que soit le droit en vigueur. Egalement, il existe actuellement des Etats "justes" (en considérant leurs valeurs) car ils se fondent sur le respect de libertés fondamentales ce serait bien de définir lesquelles. -Qu'est-ce qui rend la coexistence entre Etat et justice possible ? Quand est-ce qu'on parle des lois dans cette dissertation "lois et justice"? +Les deux valeurs communément admises de la justice sont l'égalité et la liberté ou encore l'équité, l'impartialité, la présomption d'innocence... il n'y a pas que la devise nationale, mais tu n'as jamais défini la justice, du coup tu rames un peu lorsqu'il s'agit de manier la notion. Pourtant, la première connaît de nombreuses limites, car elle ne prend pas en compte les inégalités de revenus ou de situation. Pour revenir à un système plus juste, la notion d'équité permet d'apporter une correction à la notion d'égalité, jugée trop générale. En un certain sens, l'équité ne s'oppose donc pas à l'égalité mais correspond à une égalité plus précise, c'est-à-dire à une égalité de traitement tenant compte des situations particulières des personnes ou des groupes. Les discriminations positives permettent également de corriger des inégalités dans la mesure où elles tendent à favoriser certains groupes pour compenser une inégalité de fait. Par exemple, la sous-représentation des femmes dans la haute fonction publique a conduit à l'adoption de lois sur la parité hommes-femmes qui prévoient un nombre égal d'hommes et de femmes dans les candidatures pour les scrutins de liste, les partis ne présentant pas 50% de candidats de chaque sexe devant dès lors payer une amende. L'équité et les discriminations positives semblent donc être des mesures qui apportent une justice "égalitaire" dans un Etat. Et bien c'est un très bon exemple... La loi sur la parité, qui utilise la loi pour corriger une injustice, on est dans le sujet. Mais je ne vois pas quel argument tu veux défendre avec ça, puisque tu parle encore de l'Etat. +Lorsque l'ordre institué est considéré comme injuste, une partie de la population peut se révolter contre celui-ci. Il s'agit de la révolution pensée par Marx. Selon lui, la révolution correspond au passage d'un ordre injuste, où les moyens de productions sont entre les mains d'une minorité, au passage d'un ordre juste, qu'il associe au communisme, marqué par l'abolition de la propriété privée et l'avènement de la propriété collective. Par exemple, la révolution de 1789 a permis d'instaurer un nouveau régime politique communément admis comme plus juste. Le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adopté en 1795 l'illustre en affirmant l'égalité de tous les hommes sans condition. +La séparation des pouvoirs pour garantir un Etat de droit semble également être une solution appropriée pour faire coexister justice et Etat, afin que plus aucun chef d'Etat ne puisse dire, à l'instar de Louis XIV: "L'Etat, c'est moi." Par exemple, les régimes politiques des pays développés d'Union Européenne reposent sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif, et judiciaire. Ainsi, des députés, voire des présidents, sont parfois mis en examen pour avoir enfreint la loi, comme l'ancien président Nicolas Sarkozy, accusé dans quelques affaires pour corruption et trafic d'influence notamment. Ainsi, la séparation des pouvoirs permet la coexistence de la justice et de l'Etat, puisque les organes judiciaires sont indépendants à l'égard de ceux du législatif et de l'exécutif. Conclusion: La justice et l'Etat peuvent coexister. Toutefois, lorsque l'Etat acquiert trop de pouvoirs, il peut finir par devenir écrasant par rapport aux populations qu'il domine, voire détruit. La révolution et la séparation des pouvoirs semblent être des solutions efficaces pour instaurer et garantir un Etat de droit. " Mes transitions sont-elles réussies ? De même que mon amorce ? Oui, dans l'ensemble l'écriture n'est pas mauvaise à part quelques étrangetés soulignées en rouge. Mes exemples pertinents ? Pas toujours, puisque la problématique est hors-sujet. Tu n'es jamais hors-sujet par rapport à ta problématique: tu es cohérent! Mais ta problématique tape à côté du sujet, c'est dommage. Suis-je hors-sujet ? Oui, hélas. Tu as fait des efforts pour définir la justice, mais parfois en la confondant avec l'Etat, et en confondant l'Etat avec la loi dans tout le reste du raisonnement. Avoir ramené la notion d'Etat a vraiment parasité ta dissertation et t'a empêché de parler des lois avec pertinences, à quelques exceptions près (Antigone et Créon). Quelle note puis-je obtenir avec ce plan de dissertation ? Selon la sévérité du correcteur, entre 8,5 et 9,5/20, car formellement parfait, mais hors-sujet. Je vous remercie d'avance pour votre temps et vos réponses, Calliclès. Encore une fois, je dois saluer le saut qualitatif depuis tes premières dissertations: tu écris tellement mieux, j'ai presque du mal à croire que c'est le même élève. Tu as visiblement appris de chaque exercice, tu as appris de la méthodologie et tu vas piocher dans des exemples philosophiques à chaque fois, c'est vraiment encourageant. Au moins, tu ne peux pas vraiment te planter et récolter un 4/20 pour dissertation médiocre, tu as appris à écrire quelque chose qui tient la route, ta méthode est solide, je ne vois pas comment tu pourrais sombrer sous la barre du 8/20. Maintenant, il reste un travail préliminaire à faire avant l'écriture: un travail d'analyse un peu mieux approfondi. Tu as tendance à confondre parfois certaines notions, à ne pas faire les bonnes distinctions. Pourtant, à côté de ça, dans cette dissertation tu as montré une capacité à expliquer des distinctions conceptuelles assez fines, qui démontrent une vraie compétence dans la réflexion. Mais elles ne sont pas toujours utilisées au bon endroit. Pour progresser encore un peu, il te suffit de prendre 10 à 15 minutes de plus pendant l'analyse du sujet. Avant de trouver une accroche, des exemples, une problématique, je veux que tu te poses la question: "de quoi ça parle vraiment?" Prenons ce sujet comme exemple concret: "Peut-on dire qu'il n'y a pas de justice, mais seulement des lois ?" On va l'analyser tranquillement pour que tu vois comment je procède. Cela semble peut-être élémentaire, mais on n'a affaire à deux notions: lois et justice. Juste ces deux notions, on n'a pas besoin d'en introduire une troisième tout de suite, ou alors seulement de façon limitée dans un exemple. En balayant "lois" de ta problématique pour remplacer la notion par "l'Etat", tu es parti dans une autre direction: celle du hors-sujet. Je me contenterais d'une problématique connectant ces deux notions, mais dans le corps du raisonnement je m'autoriserait, sans confusion, à utiliser parfois des notions complémentaires comme par exemple l'Etat (qui promulgue et garanti l'application des lois) ou la morale (qui reste de l'ordre conceptuel, mais précède logiquement l'idée de justice: finalement la justice, c'est de la morale appliquée). Ensuite, faisons attention au vocabulaire précis: "lois" au pluriel, on parle donc des lois qui ont été écrites de fait, pas forcément du concept: la loi, qui s'écrirait au singulier. La justice, elle, est au singulier, donc on parle bien du concept philosophique de justice et pas seulement des procédures pénales et des tribunaux. De plus, il y a cette question formulée par "peut-on dire?" qui place le sujet dans le discours. Et si possible le discours rationnel: peut-on dire avec bonne foi et argumentation que la justice n'existe pas, seulement la loi ou la police? En l'état, si tu réponds "oui, on peut le dire, merci de m'avoir lu." on va te reprocher de ne pas avoir justifié ta réponse pas un discours rationnel argumenté. Ensuite, pourquoi "seulement" des lois? Cela veut dire que les notions du sujet sont connexes et que l'une est subordonnée à l'autre: "des lois" serait un élément de l'ensemble "justice". Comme le pouce fait partie des doigts, ou le 14 fait partie des nombres entiers positifs. Alors comment distinguer la justice des lois? Et peut-on trouver des lois injustes? Est-ce que cela a du sens, logiquement, une "loi injuste"? Ensuite, il y a un paradoxe que tu n'as pas vu à l'analyse du sujet, et tu le payes cher par un hors-sujet. Comment pourrait-on dire "il n'y a pas de justice, seulement des lois", alors que les lois sont écrites et votées pour être appliquées en justice? L'existence même des lois suppose un sentiment d'injustice, des intuitions morale amenant à l'idée de justice. Donc la réponse est évidemment: non, on ne peut pas dire ça, c'est une opinion cynique qui relève ultimement de la contradiction logique. Nous allons voir comment les lois impliquent la notion de justice (le simple fait d'écrire une loi suppose qu'on vise un idéal, tout en acceptant qu'il ne sera pas toujours respecté en pratique, c'est justement pour ça qu'on prévoit des punitions: le volant pénal des codes de loi), mais aussi comment ces deux notions peuvent se contredire (ton exemple du IIIe Reich qui écrit des lois injustes, et l'exemple d'Antigone et Créon, qui illustre parfaitement le conflit entre la justice morale ou divine, et les lois dictées par les mortels). -

Correction dissertation: L'Etat et la justice
Calliclès a répondu à un(e) sujet de DJhuff dans Philosophie
Salut DJhuff, Puisque le bac philo est dans trois jours, je vais mettre le turbo et te corriger ça le plus vite possible dans la nuit. Je ne pourrais pas te répondre demain, je suis assesseur pour les législatives, donc je vais me taper la tenue du bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement (22h20, 23h, ça va dépendre). Alors trêve de blabla, on s'y met tout de suite! Je reprends ta réponse et j'écris mes remarques en gras, comme d'habitude. Les conseils ou remarques en vert, les corrections en rouge. -

Corrigé dissertation: La religion et la raison
Calliclès a répondu à un(e) sujet de DJhuff dans Philosophie
Tu ne vois pas ce qu'il y a de caricatural à prendre comme exemple des suicides collectifs pour parler de religion? Entre la pratique ordinaire des religions et les dérives sectaires, il y a des connections bien sûr: le discours religieux est souvent utilisé par des gourous. Mais c'est un autre rapport social. Puisque le thème est la religion dans son ensemble, ramener ça aux attaques terroristes, c'est très réducteur, et surtout ça nous éloigne du sujet, puisque tu ne vas plus parler de dérive sectaire et de terrorisme dans le reste du texte. Toute ta synthèse porte sur l'aspect social de la religion, du coup je ne comprends pas ce que les suicides collectifs viennent faire en accroche. Ils sont évoqués, puis tu les lâches, ils ne servent à rien. C'est pour cela que je trouve l'exemple caricatural et un peu hors-sujet. Ta troisième partie ne compare pas du tout raison et religion, contrairement à ce que tu affirmes. J'ai relu les trois sous-parties, et seul l'argument de Durkheim a vaguement un rapport avec la raison. L'argument de Marx sur l'opium du peuple permet d'expliquer le succès social de la religion auprès des pauvres, et l'argument "la religion est universelle" confine au sophisme. Le phénomène religieux est universel, effectivement. Mais chaque religion n'est pas universelle, elle est toujours locale (ce qui pose problème lorsqu'elle prétend être universelle et commence à essayer de tuer les autres religions, comme le catholicisme ou l'islam sunnite: cette logique "ma religion est universelle et pas les autres" amène à des conflits armés). D'autre part, il n'y a pas de comparaison avec la raison qui elle, pour le coup, est vraiment universelle! On n'a pas besoin d'être dans la même culture, de parler la même langue ou d'avoir appris la même cosmogonie pour tomber d'accord sur des conclusions rationnelles. Le théorème de Thalès est formulé en Grèce, très bien, mais il est universellement vrai partout où se pratique la géométrie plane, qu'on soit Grec ou pas, il n'est pas relatif à ta culture. Pour ta troisième partie, si le but est de conclure que les deux sont effectivement radicalement opposés, tu peux prendre des exemples de cette contradiction. La façon dont les découvertes scientifiques ont définitivement invalidé les mythes religieux (depuis Cuvier et Darwin, si on veut continuer de croire en l'interprétation littérale de la Genèse sur l'origine du monde et de l'humanité, il faut le faire contre les faits). Ce qui amène à un de mes arguments préférés de Nietzsche: dieu est mort (Le gai savoir, §125). C'est du langage poétique: dieu ne peut pas vraiment mourir puisqu'il est immortel pour les croyants et inexistant pour les athées. Mais cela veut dire que la science a tué l'utilité de croire en dieu: l'idée de dieu est devenue inutile pour la compréhension du monde (merci Galilée, Cuvier, Darwin et tous les autres: leurs travaux invalident l'hypothèse que les mythes religieux soient vrais). Cela ne signifie pas la mort des religions, bien sûr: si les mythes n'ont pas de réalité, la religion garde sa foi et son culte. Et l'immense majorité des croyants s'accommodent très bien de la mort de dieu: ils considèrent les mythes comme une parabole morale qui n'a pas besoin d'être littéralement vraie pour contenir un enseignement sur le monde (une attitude intellectuelle déjà répandue au Moyen-Âge et qui n'a pas attendu l'athéisme, Averroès critiquait déjà les "littéralistes" au XIIIe siècle dans son Al-Hasif, les traitant comme une quantité négligeable de naïfs auxquels il n'a pas besoin de s'adresser). Voici quelques indices pour ta synthèse, donc. Je te laisse conclure! Je répondrai sur le travail plus tard, je vais cuisiner un peu ce soir! -

Corrigé dissertation: La religion et la raison
Calliclès a répondu à un(e) sujet de DJhuff dans Philosophie
Alors: cette amorce est problématique parce qu'elle est caricaturale, malheureusement. On ne peut pas réduire la religion, qui est une notion très vaste, aux cas spectaculaires de suicides collectifs dans des sectes. Un meilleur exemple serait: les peines de prison pour athéisme dans les théocraties, la condamnation de Giordano Bruno par l'église catholique pour avoir remis en cause la physique soutenue par le Vatican, ou plus proche de nous le très intéressant "procès du singe" de 1925, dans lequel créationnistes et évolutionnistes s'affrontent en justice pour décider de la légalité ou non d'enseigner la théorie de l'évolution dans les écoles publiques (un procès remporté par les créationnistes, mais un cas médiatique largement en faveur des évolutionnistes, qui ont aujourd'hui largement remporté le débat). Pour ce qui est de résoudre la contradiction: et bien si tu as tranché en faveur d'un des termes, c'est que la contradiction est résolue par l'élimination d'un opposé. "résoudre la contradiction" ne veut pas forcément dire que tu dois trouver une voie moyenne ou un terrain d'entente entre les deux, mais que tu dois apporter une solution. Si ta solution est "la raison doit l'emporter, tant pis pour l'ego des conservateurs religieux", je ne vois pas le problème du moment que c'est argumenté correctement. Ta deuxième problématique est parfaite, garde-la. Tes deux premières parties sont intéressantes. Tu gagnes en finesse et en références! Attention avec Averroès cependant: ce n'est pas un auteur facile, ni un auteur que tu as envie d'assumer jusqu'au bout (d'après Averroès, les juges coraniques ne sont pas capables d'utiliser la raison démonstrative, mais seulement une raison analogique: ils comparent les faits aux lois et aux exemples qu'ils connaissent déjà, ils seraient donc incapables de philosopher pour former de nouvelles lois par eux-mêmes et devraient foutre la paix aux philosophes, qui sont les vrais savants capables d'utiliser toute l'étendue de la raison... Honnêtement, de toute la philosophie médiévale, c'est un des plus beaux "fermez vos gueules et laissez-moi bosser, vous êtes incapables de faire mon boulot de toute façon" qu'un philosophe ait jamais adressé à des fondamentalistes religieux). Mais pour le niveau attendu en Tle, ta compréhension d'Averroès est largement suffisante. Attention à ta troisième partie: elle répond à une sous-problématique annexe "que peut apporter la religion?" qui devient hors-sujet... Parce qu'il n'est plus question du rapport entre religion et raison, mais plutôt de la religion seule. Et c'est dommage, car je trouve une grande qualité dans l'utilisation de l'exemple de Marx avec "l'opium du peuple", tu as parfaitement compris que Marx ne fait pas allusion seulement au côté addictif de cette drogue, mais à son effet apaisant, qui permet de supporter la douleur de l'existence. Si Marx avait vécu aujourd'hui, il aurait peut-être écrit "la religion est le doliprane codéiné du peuple" ? Donc il y a une finesse intellectuelle qui se développe dans ton utilisation des auteurs, c'est vraiment de mieux en mieux et je trouve que tes progrès sont considérables. Relis une de tes premières dissertations, tu verra le chemin parcouru. -

Corrigé dissertation: La religion et la raison
Calliclès a répondu à un(e) sujet de DJhuff dans Philosophie
J'ai un problème dès le début. Ton accroche est très forte, mais surtout très orientée. Dans le débat "religion et rationalité", tu commences tout de suite par "secte et suicide collectif"... Bon. Je pense que tu n'as pas pris beaucoup de recul sur le sujet. On va en parler quelques secondes. Le but est de disserter sur la contradiction possible entre religion et rationalité. Religion au sens large: avec sa partie intellectuelle, la foi, le dogmatisme, le fanatisme, mais aussi simplement le fait social religieux de se réunir pour un culte (les messes des catholiques, les offices des protestants, les prières bouddhistes, les enterrements juifs, les mariages... on n'est pas obligé de dégainer les suicides collectifs et les attentats-suicides de djihadistes tout de suite, il y a d'autres trucs dans la religion). La religion n'est pas qu'un système de croyances qui peut rentrer en contradiction, ou non, avec la raison et ses recherches. La religion, pour faire court, peut se ramener à au moins trois composantes: 1) la foi, un élément déjà introduit par le judaïsme, mais rendu encore plus important par le christianisme, qui en fait l'élément central. C'est l'aspect strictement intérieur de la religion, qui demande d'accepter l'existence d'une divinité. Dans le christianisme médiéval, la confession se décline en trois parties: confession fidei (confesison de sa foi, ce qu'on appelle aujourd'hui profession de foi), confessio laudati (profession des louanges à dieu, une prière rituelle) et confessio peccati (confession des péchés) étant la dernière, alors que c'est ce qu'on retient aujourd'hui. La plus importante était la confessio fidei, puisqu'elle affirme notre croyance intime. 2) les mythes, le système de croyances sur a) l'origine du monde (une cosmogonie qui s'appuie souvent sur les connaissances astronomiques du peuple qui a inventé cette religion), sur b) l'origine de l'humanité (mythe des origines, qui peut prendre de nombreuses formes), et c) le sens de la mort (l'après-vie, enfer, réincarnation, âme immortelle ou pas, c'est là que les religions ont besoin de philosophes pour leur inventer une ontologie), des questions auxquelles toutes les religions prétendent répondre. EXEMPLE: Dans la mythologie biblique, la cosmogonie est celle de la création du monde en six jours ("que la lumière soit"), le mythe des origines est celui d'Adam et Eve expulsés du jardin d'Eden, et le sens de la mort fait appel au mythe d'une âme immortelle amenée à rejoindre dieu. Le christianisme reprend ces éléments, il partage la même cosmogonie et le même mythe des origines, mais il change un peu le sens de la mort, puisqu'on va rejoindre le "royaume de dieu" avec une âme qui reprend la forme du corps dans l'au-delà. Chez les musulmans, le mythe de l'après-vie est encore plus précis, puisque certains pensent que non seulement le corps revient dans l'au-delà, mais c'est un corps de lumière à sept points lumineux (les sept points de contact avec le sol pendant la prière) qui prend l'apparence de 33 ans ('âge de Jésus, qui est un prophète pour les musulmans aussi). Selon la religion, l'époque et le contexte social, le statut de ces mythes évolue beaucoup. Dans la Grèce classique on pouvait douter des mythes, du moment qu'on assistait aux événements religieux. Les dialogues de Platon nous montrent clairement qu'on peut même inventer des mythes pour les rajouter au corpus (on pourrait inventer une nouvelle religion, plus originale et intéressante que le christianisme, juste en lisant Phèdre, et si Platon n'a pas forcément proposé une nouvelle religion, d'autres philosophes grecs ont carrément monté des sectes avec un système de croyances complexe, comme Pythagore). A d'autres époques moins ouvertes au débat intellectuel, les mythes deviennent dogmatiques et on ne doit pas les remettre en question sous peine d'hérésie (ce qui pose tout un tas de problèmes: comment sauver les mythes malgré les découvertes scientifiques? Les fondamentalistes en sont réduits à débiter des âneries pour sauver leur pauvre interprétation littérale, comme affirmer que la Terre est plate et que dieu a créé le monde en six mille ans, ce genre d'absurdité). Tout ça, c'est bien beau, mais évidemment ça n'a aucune autre légitimité que la foi. Il n'y a aucune preuve, et souvent aucun sens rationnel à ces mythes. Aucun d'entre eux n'a donc de légitimité particulière du point de vue des rationalistes. La Bible dit que Yavhe a créé Adam et Eve, mais les Esquimaux ont apparemment un mythe des origines totémiste, prétendant qu'on descend des écureuils. Et pour les adeptes des mythes méso-américains (de Teotihuacan): il y a eu quatre ères, avec quatre soleils ratés qui ont détruit le monde et les premiers humains sur Terre, avant qu'arrive le cinquième soleil, issu du sacrifice d'un dieu humble, puis le Serpent à Plumes (Quetzalcoatl) est descendu au monde souterrain des morts (le Mitclan) pour récupérer les os des premiers humains, et il les a imprégnés de son sang et de poussière pour les ramener à la vie et créer l'humanité actuelle. Les Aztèques ont un mythe similaire, mais quand même assez différend: leur religion appartient à la même civilisation, mais c'est une autre culture. Et tu peux aller en chercher partout: toutes les religions du monde te proposeront des mythes différents, je t'invite à te documenter sur la cosmogonie des Hindous, des Egyptiens, des Grecs, des Sumériens, des Japonais... C'est passionnant. L'important est de retenir que pour les rationalistes, ils sont tous également intéressants d'un point de vue anthropologique, et factuellement erronés d'un point de vue astrophysique, géologique et biologique. 3) Le culte, un fait social qui réunit des gens autour de célébrations pour rythmer la vie sociale: baptêmes, mariages et enterrements dans beaucoup de religions. Mais aussi de nombreuses fêtes qui rythment tellement le calendrier qu'elles ont pris plus d'importance que les événements astronomiques qui créent le passage des saisons, comme les solstices et les équinoxes qui étaient probablement des fêtes religieuses importantes au néolithique (c'est en tout cas ce que suggèrent les mégalithes de l'époque, qui sont orientés pour recevoir la lumière des solstices sans qu'on sache exactement pourquoi, Stonehenge parmi d'autres). Dans notre modernité, la foi a pris de plus en plus d'importance en tant qu'acte individuel, la foi est devenue personnelle. Mais ça n'aurait probablement aucun sens pour nos ancêtres de l'Antiquité, qui ne comprendraient même pas de quoi on parle et se contenteraient de dire: "mais du coup, le sacrifice à Poséidon qu'on fera au port, tu y va ou pas? Il y aura Socrate et Calliclès, on dit une prière et après on va manger le boeuf sacrifié en grillades." Ceci étant dit, je te propose de voir ta problématique: "la religion peut-elle tolérer l'usage de la raison?" ne résout pas la contradiction. Elle renvoie la question à du factuel: "est-ce que ça peut exister?", et comme toutes les problématiques de ce genre elle a deux défauts: 1) la réponse est "oui, ça peut exister, ça a déjà existé quelque part" qui coupe court à la discussion, et beaucoup plus grave, 2) ce n'est plus une question pour le philosophe. C'est une question pour les historiens, au mieux les historiens des idées, qui pourront citer toutes les sources qu'ils veulent pour nous montrer documents à l'appui que oui, la religion a déjà fait ça à une certaine époque (et c'est très bien, mais ça n'était pas exactement la question, tu as réduit le problème à ses occurrences historiques). La question philosophique est: y a-t-il une contradiction formelle entre raison et religion, et si oui comment peut-on la résoudre? Donc une partie de ton boulot est d'argumenter pour ou contre cette contradiction, de la critiquer (en philosophie, critiquer est un art noble, c'est l'essence de notre boulot, la critique est proprement philosophique! Quand mes amis disent que je critique tout, eux pensent me faire un reproche parce que je suis un peu chiant, mais je leur réponds "merci, c'est mon travail de philosophe et j'aime le faire." fin de la parenthèse). Alors, d'après toi, est-ce que la raison et la religion s'opposent? Si oui: comment? De quelle nature est cette opposition: contrariété (qui peut s'accommoder de la présence de son opposé, comme le sucré-salé, l'eau et l'huile, l'être et le néant, la lumière et la simple pénombre) ou contradictoire (qui détruit son opposé par sa simple présence, comme l'être et le non-être, l'obscurité totale et la lumière, le vrai et le faux, le bien et le mal, la dignité et Manuel Valls?) EXEMPLE: Dans la religion, on l'a dit, il y a une cosmogonie (du grec kosmos, univres, et gêne, le commencement, la création, le point de départ du lignage, qui donne aussi le mot "génétique") Et chez les rationalistes? Les astrophysiciens, qui bossent dur sur les débuts de l'univers (ou en tout cas les moments les plus anciens qu'on puisse en percevoir), parlent de cosmologie (discours sur le cosmos). Mais puisqu'on a vu que toutes les cosmogonies religieuses sont contradictoires, qu'elles ont des récits variés, est-ce que la cosmologie ne serait pas un discours de plus? Une sorte de mythe des origines de l'univers pour scientifique? Et bien non: les astrophysiciens fonctionnent peu à la croyance et beaucoup plus aux observations. Leur cosmologie prétend que l'univers a eu des débuts chauds et très réduits, avant de commencer une expansion brutale il y a plus de 13,4 milliards d'années (ce que les journalistes scientifiques des années 1950 ont résumé par la formule accrocheuse et mensongère "big bang"). Une expansion qui se poursuit aujourd'hui. Mais cette cosmologie s'appuie sur des découvertes et des observations (le fond diffus cosmologique, par exemple, ou les applications de la thermodynamique à l'extrêmement lointain). Cela forme une théorie scientifique cohérente, qui explique les observations actuelles. Autrement dit: quelle que soit la cosmogonie religieuse qu'on ait appris dans son enfance, la cosmologie reste la meilleure explication pour qui a jamais mis l'oeil dans un télescope. Elle ne demande aucun acte de foi, et elle n'est pas dogmatique: elle est solide, mais pourrait être remise en question n'importe quand dans l'avenir, à la faveur d'une nouvelle découverte, et celui ou celle qui arrivera à révolutionner la cosmologie avec une observation inédite ne sera pas condamné à mort pour hérésie, il ou elle publiera son article dans Nature , des astrophysiciens du monde entier essaieront de reproduire ses observations, une nouvelle génération d'astrophysiciens fera de sa découverte le point de départ de leur thèse et il ou elle finira probablement par décrocher un prix Nobel. Donc on peut le dire: cosmologie et cosmogonie ne sont pas égales, elles ne fonctionnent pas de la même façon ni selon la même logique, elles ne font pas appel aux mêmes facultés mentales. Là où toutes les cosmogonies du monde sont des récits, des narrations inventives et magnifiques, elles ont plus de rapport avec la poésie antique qu'avec n'importe quelle observation du monde. Tandis que la cosmologie est une science, c'est-à-dire une activité qui demande d'observer le monde en écartant ses croyances avant de former une explication rationnelle.